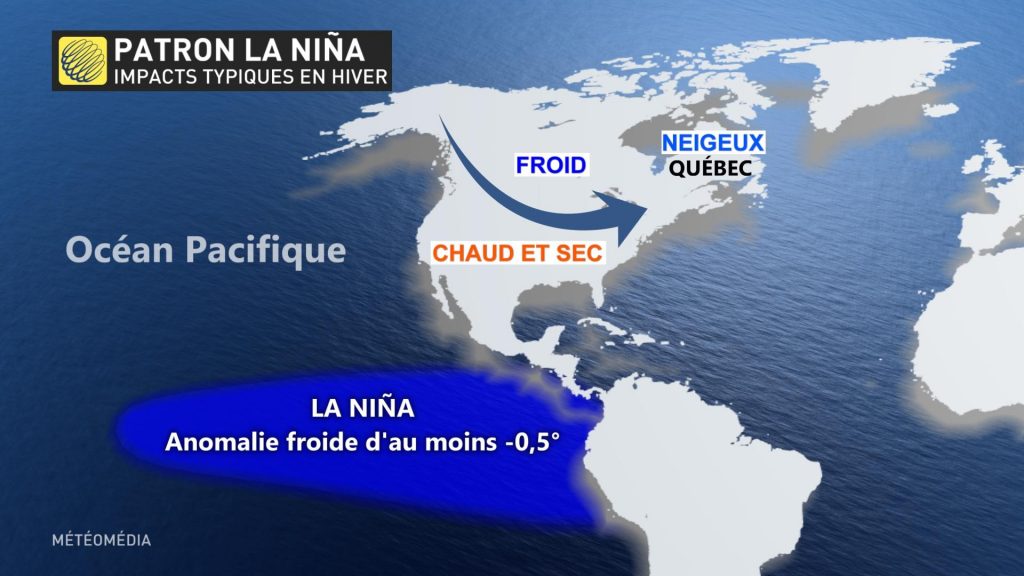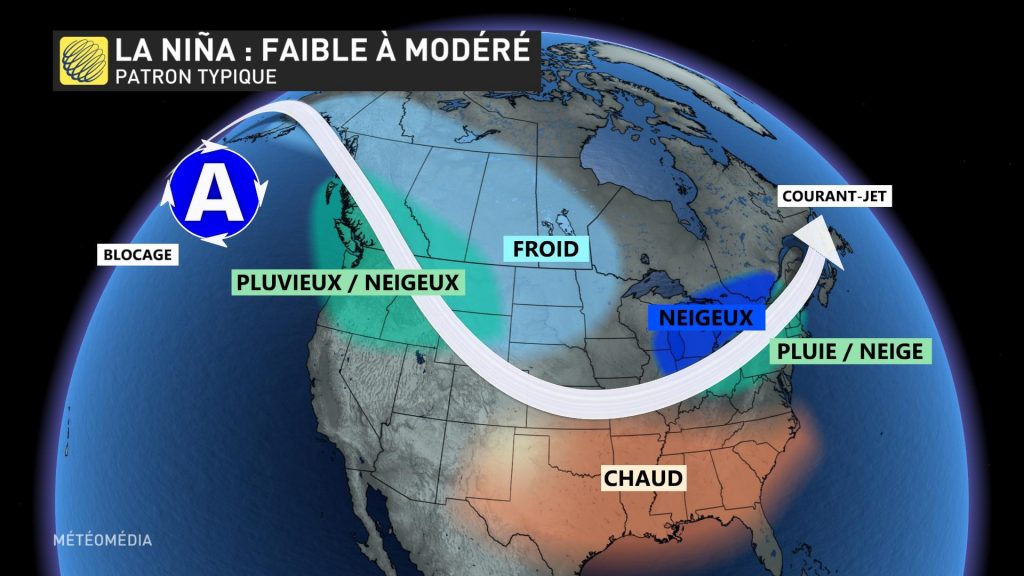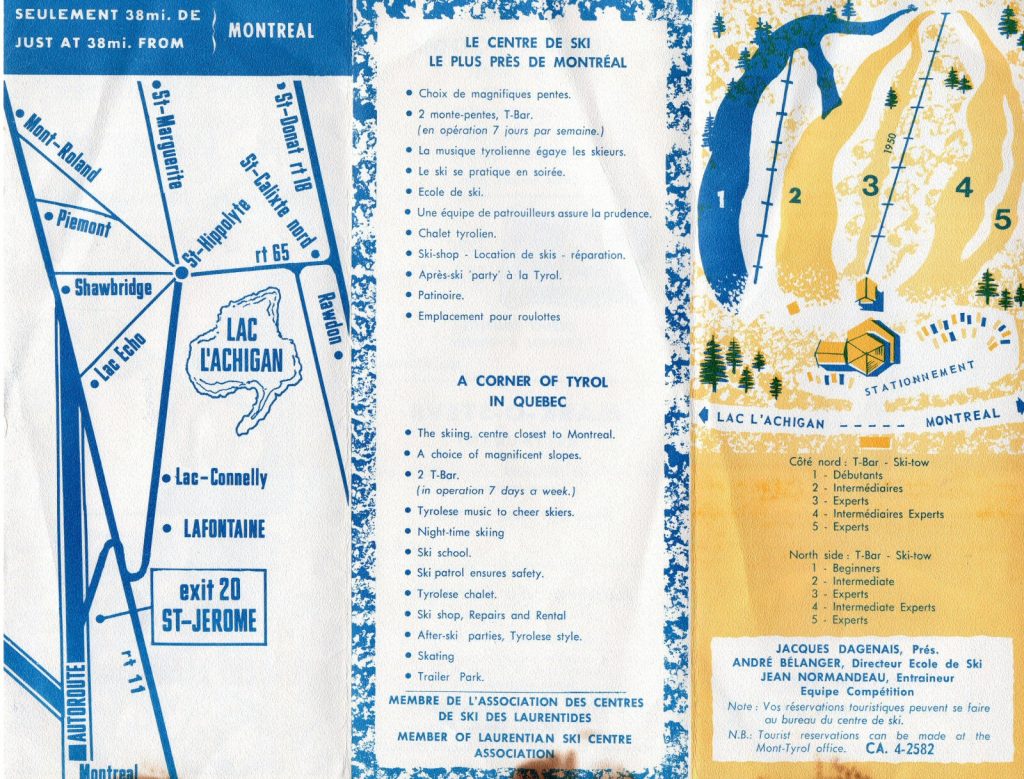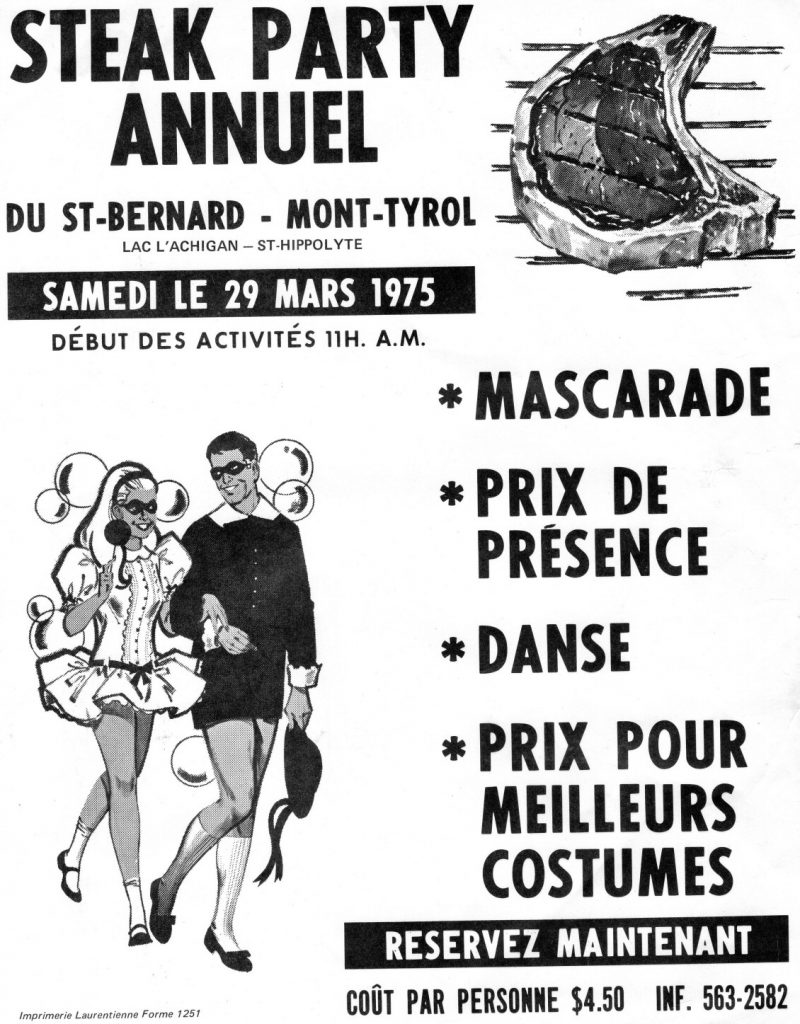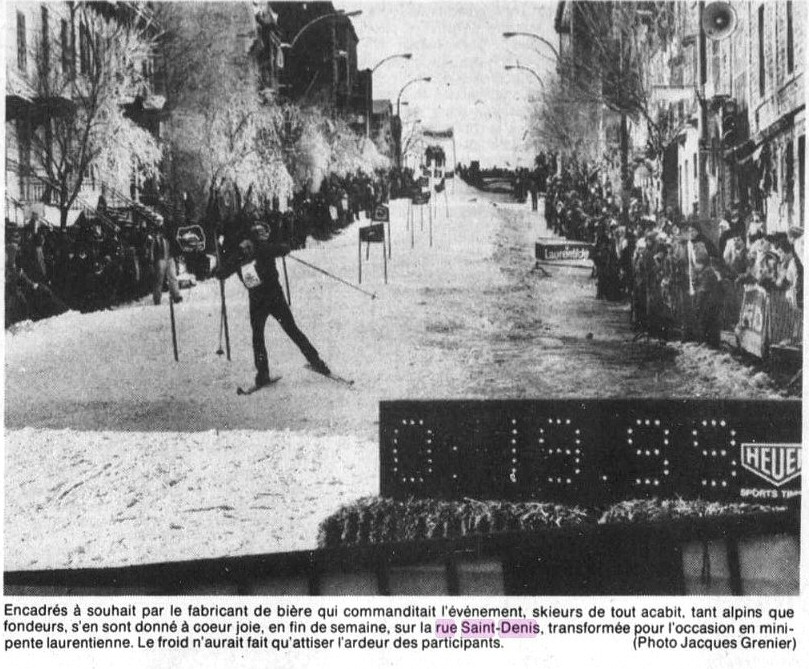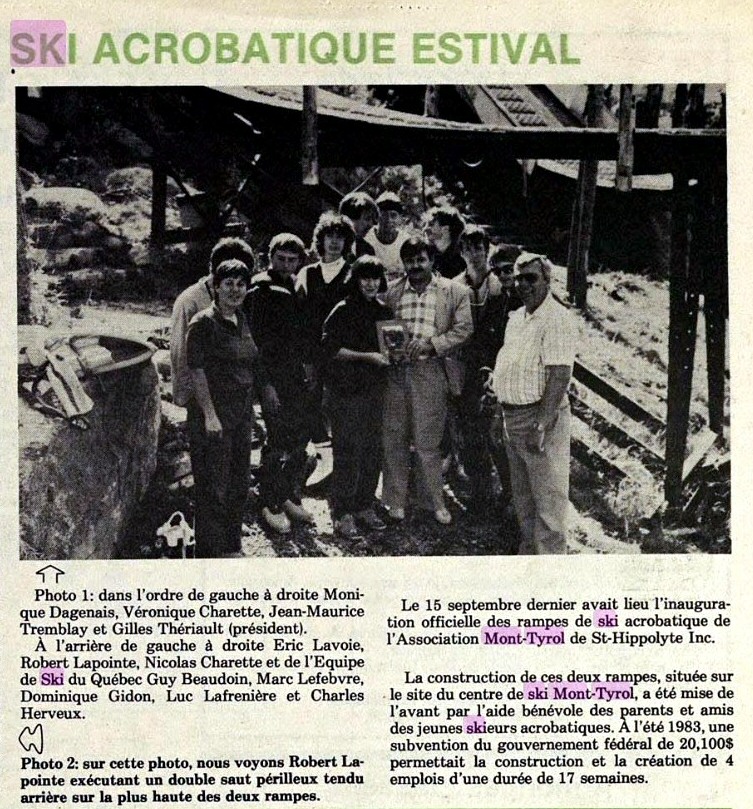La nouvelle circule depuis les petites heures en ce 2 novembre 2021: le passeport vaccinal sera exigé pour fréquenter les stations de ski de la province dès l’ouverture de celles-ci. En octobre dernier, nous avions publié un texte qui reprenait les grandes lignes des restrictions en vigueur pour les activités d’automne. Plusieurs stations avaient déjà alors affiché les informations en indiquant qu’elles pourraient être modifiées d’ici au début de la saison hivernale. Ces politiques seront donc mises à jour avec les informations suivantes.
Différentes règles pour les sports hivernaux
Le passeport vaccinal était déjà exigé pour toutes les activités sportives pratiquées à l’intérieur (gymnase, badminton, etc.), ainsi que pour les activités culturelles ou de loisirs: cinéma, restaurant, bars, spectacles, etc. Pour cet hiver, la pratique des sports hivernaux extérieurs sera soumise à différentes règles d’accès. En point de presse mardi après-midi, les instances gouvernementales ont confirmé l’information qui coulait depuis quelques heures. L’annonce d’aujourd’hui vient clarifier et répondre à toutes les questions.
Pour l’accès aux sports hivernaux extérieurs à accès libre (ski de fond, patin, raquette, ski de randonnée, par exemple), on n’exigera PAS le passeport vaccinal, mais les participants sont tenus de respecter les gestes barrière: lavage fréquent des mains, respect d’une distance de plus de 1 mètre, port du couvre-visage à l’intérieur (chalet, refuge).
Pour les sports demandant l’utilisation d’un remonte-pente: le passeport vaccinal SERA EXIGÉ pour tous les visiteurs de 13 ans et plus, avec la même habitude du port du couvre-visage dans les télécabines fermées (comme l’an dernier, foulard ou cache-cou conviendront dans les remontées). Ces règles seront en vigueur dès le 15 novembre 2021.
Les procédures de vérification du statut vaccinal des visiteurs en station seront dévoilées sous peu: chaque station de ski ayant une configuration particulière en terme de stationnements, d’accès aux chalets ou aux pistes, les dirigeants doivent encore se pencher sur la meilleure manière d’effectuer ces vérifications afin de limiter l’impact sur la circulation et les accès aux services. À noter que les skieurs qui ne disposent pas d’un téléphone intelligent doté de l’application VaxiCode doivent penser à imprimer et plastifier (ou protéger par une pochette) leur preuve vaccinale, disponible en ligne. Cette preuve vaccinale, jumelée à une pièce d’identité, garantira l’accès aux stations.
L’application du passeport vaccinal dans les stations de ski du Québec permettra à celles-ci de fonctionner à 100% de la capacité de leurs remontées mécaniques, ce qui constitue un soulagement pour les gestionnaires des stations. Après avoir traversé la saison dernière malgré les incertitudes et les changements, les stations de ski accueillent très positivement cette nouvelle. Dans un communiqué émis quelques minutes après le point de presse, l’Association des stations de ski du Québec se réjouit: « C’est une excellente nouvelle de pouvoir opérer à 100 % la capacité des remontées mécaniques et de ne plus avoir à limiter le nombre de visiteurs à l’extérieur. Pour l’industrie du ski, la mise en place du passeport vaccinal constitue assurément un défi opérationnel, mais elle permet des assouplissements bien perçus par l’ensemble des exploitants. Nos sondages démontrent que la très grande majorité de notre clientèle est favorable au passeport vaccinal. Les visiteurs pourront donc profiter des pentes enneigées du Québec en toute tranquillité d’esprit cette saison. » déclare Yves Juneau, président-directeur général de l’Association des stations de ski du Québec (ASSQ).
Le personnel vacciné également ?
(Mise à jour 16h00) Selon les consignes acheminées aux stations de ski, d’après les directives de la CNESST, aucun employé ni bénévole considéré comme travailleur (patrouilleur, par exemple) n’est assujetti à la validation du passeport vaccinal lors de ses journées de travail en station. Les employés qui ne sont pas complètement vaccinés peuvent donc continuer à effectuer les tâches pour lesquelles ils sont embauchés.
Les preuves vaccinales en ski: pas un cas unique au Québec
Dans l’ouest canadien, RCR a fait l’annonce hier (1er novembre) que les stations de son groupe (Nkiska Ski Area, Fernie Alpine Resort, Kimberley Ski Resort et Kicking Horse Mountain Resort) exigeront une preuve de couverture vaccinale suffisante pour fréquenter les pentes pour la saison. La station vancouvéroise Grouse Mountain avait fait une annonce identique il y a plus de deux semaines. Plusieurs stations voisines emboiteront sans doute le pas.
En Europe, pour l’instant, aucun passeport vaccinal (pass sanitaire) n’est exigé pour aller en ski mais cette condition risque de changer, selon la détérioration de la situation épidémiologique. Les pays ont des politiques différentes d’accès selon le statut vaccinal des visiteurs (quarantaines, preuves de tests négatifs).
La pensée ZoneSki
Cette nouvelle est réjouissante non seulement pour les stations qui opèreront à pleine capacité, mais aussi pour plusieurs skieurs qui, l’an dernier, se sont privés de leur loisir préféré, faisant partie d’un groupe de population plus à risque. Qu’il s’agisse de leur âge ou d’un problème de santé chronique, beaucoup ont fait le choix de mettre la pratique du ski alpin sur pause pour leur sécurité, en attendant de voir les conditions pour la saison 2021-22. Comme pour tous les sports et loisirs, le ski alpin est une activité qui nous permet une évasion du stress quotidien, et tous souhaitent en tirer un maximum de bonheur. Ce sera à nouveau possible cette année, dans un contexte sécuritaire pour tous. À vos planches, bon ski!