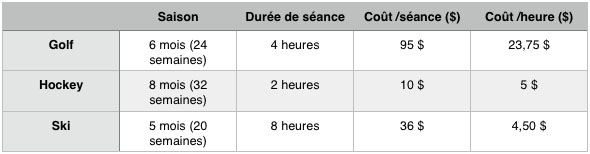Le centre de glisse Mont Apic, situé à St-Pierre-Baptiste dans la région Centre-du-Québec, a ouvert ses portes à l’hiver 1959-1960. Cette petite station familiale compte 14 pistes variées pour tous les niveaux de skieurs et planchistes. Offrant également des glissades sur tube et des pistes de raquette, l’endroit fait le bonheur de la population locale. Lors de ma visite, j’ai eu la chance de rencontrer des gens fiers et profondément impliqués au sein de leur station. Je n’ai pas eu besoin de poser beaucoup de questions: les passionnés parlent sans se faire prier!
Comment faire plus avec moins?
Normand Goulet, bénévole et acteur dans le développement de la station, n’avait que 5 ans lorsque la station a ouvert ses portes. C’est avec un plaisir évident qu’il m’a raconté des anecdotes parfois aux allures de légendes sur l’histoire du centre de ski. « Dès les premières années, il a fallu se battre », me disait-il. « J’étais jeune mais j’avais de bonnes oreilles pour entendre les conversations des adultes. Il y avait entre autre un cultivateur réticent à laisser un lot de terrain qui allait rendre la station plus fonctionnelle. Il ne comprenait pas que l’on puisse sacrifier des érables pour faire des pistes de ski. À certains endroits, au contraire, on a du planter des arbres car on voulait garder la neige dans nos pistes. Le premier chalet a été construit avec des anciennes bandes de patinoires par six hommes », poursuit-il. Personne n’était payé! Et aujourd’hui c’est encore comme ça : la plupart des gens qui s’impliquent ici sont bénévoles.
M. Goulet se souvient que pour faire fonctionner l’ancienne remontée mécanique, un moteur leur était bien entendu indispensable. À chaque hiver, deux mécaniciens s’affairaient à démonter le moteur de la seule moissonneuse batteuse de la région afin de l’emprunter pour faire rouler le câble. La rumeur veut que cette opération ait été réalisée à l’insu du propriétaire… du moins les premières années.
Le bénévole, livre d’histoire parlant, poursuit: « À partir des années 1970, afin d’être compétitifs et garder les skieurs à la station, on a fait l’acquisition de dameuses que d’autres stations ne voulaient plus. On avait de bons mécaniciens qui étaient prêts à mettre le temps nécessaire pour les remonter à neuf! Un coup, comme les tractions s’usaient vite, on a même fabriqué des chenilles pour un dixième du prix que ça valait! Et c’est moi qui damais les pistes! »
M. Goulet me raconte ensuite par quelles astuces et gentilles entourloupes ils avaient réussi à obtenir l’ancien téléski du Mont Arthabaska à bon prix et à le déménager. Les yeux brillants, il m’a longuement parlé des hauts et des bas de la station. Ce n’est pas pour rien qu’on le taquine en le surnommant l’encyclopédie du Mont Apic! Au fil de la discussion, il m’a nommé plusieurs bâtisseurs, familles, ou anciens présidents qui se sont impliqués afin que la station demeure ouverte à chaque hiver. La plupart d’entre eux ont d’ailleurs une piste qui porte leur nom, à commencer par… la Goulet!
La tradition de débrouillardise se poursuit
Lors de mon passage, la directrice générale de la station, Marie-Josée Côté, était en pleine séance de formation en vue d’obtenir son certificat niveau 1 de l’AMSC… Cela prouve que dans les petites stations de ski, tout le monde doit savoir tout faire ou presque! C’est d’ailleurs à titre de placier à l’entrée du téléski du secteur débutant que je vis à l’oeuvre Richard Taschereau, co-directeur de l’école de glisse. Un peu plus tôt dans la journée, celui-ci me donnait des chiffres reflétant l’état actuel de la station : 13 patrouilleurs, 10 moniteurs, 125 inscriptions par année aux cours de groupe, une poignée d’employés et des dizaines de bénévoles qui s’impliquent de diverses façons. J’ai également eu droit à l’historique du domaine skiable, qui n’a bien sûr pas toujours eu ses 14 pistes!
Alors que j’étais dans le chalet, je vois arriver un homme marchant d’un pas rapide. Au passage, il informe la préposée de la billetterie qu’il s’en va à son local pour réparer une pièce du téléski du secteur expert qui venait de tomber en panne. Environ 2 heures plus tard, la remontée était repartie! Après m’être informé, j’ai su qu’il s’agissait d’un de ces entrepreneurs impliqués et toujours prêts à donner un coup de main.
Une situation financière fragile
Tout comme les autres stations régionales, le Mont Apic doit compter sur des subventions et des commandites afin de boucler son budget annuel. Pendant que les hivers varient, les coûts d’opération, eux, ne cessent de croître. Malgré une assez bonne saison, un grand soutien de la population régionale et une gestion serrée, le centre de glisse a tout de même enregistré une perte réelle d’opération de l’ordre de 22 000 $ sur un budget de quelque 185 000 $ en 2012-2013 (détails ici).
Cette année, afin de garder la relève active et motivée, l’équipe de direction s’est inspiré du Mont St-Bruno en mettant en place un projet impliquant directement la clientèle adolescente dans l’élaboration du parc à neige. C’est maintenant eux qui le conçoivent et s’en occupent. Après tout, la fierté, il faut la cultiver!
Les stations de ski régionales ont-elles un avenir? Je n’ai pas de boule de cristal, mais ce que j’ai vu au Mont Apic me convainc qu’avec de l’entraide, de l’implication et de la détermination, tout est possible. Longue vie à cette belle gang de passionnés!